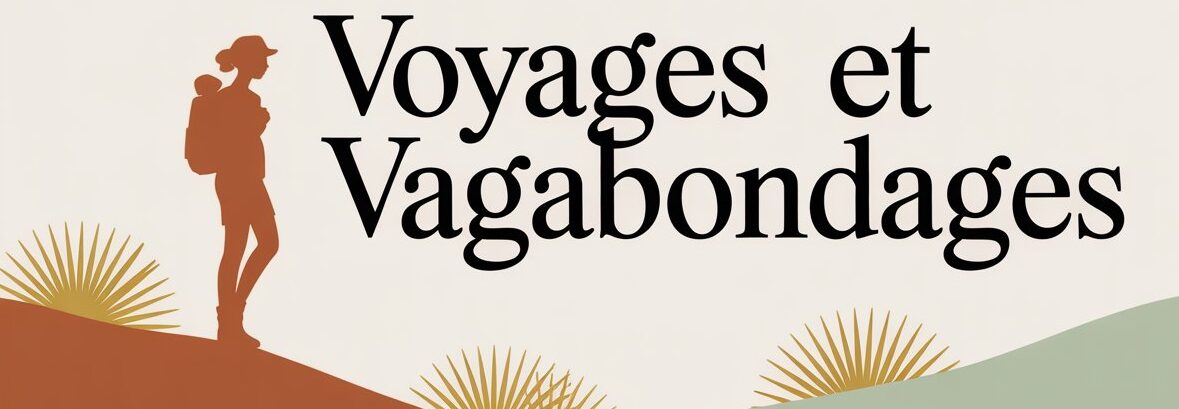Il y a tant de lieux que je n’ai jamais raconté. Il y a tant d’articles que je n’ai jamais écrits. Pendant des années, je me disais que je n’avais pas le temps, que j’y viendrais un jour, que je rattraperais mon retard. Les destinations s’empilaient, une centaine d’idées d’articles voguaient dans mes notes et je n’avais jamais l’espace, le temps ou la capacité de m’y mettre. Mon blog a pris un sabbatique et puis sa retraite. Ces articles n’ont jamais été écrits. Tout comme mon livre sur le voyage en solo n’a jamais été terminé ou publié, malgré les heures de travail, et ses quatre brouillons.
Aujourd’hui, après ces années de thérapie, d’introspection, de coaching, en étant devenue coach de créativité, j’ai beaucoup plus de recul et je suis bien moins naïve. Ce n’était pas qu’une question de temps. Il y avait, pour chacune de ces destinations, chacun de ces articles fantômes qui ne verraient jamais le jour, un blocage, une raison profonde à sa non-existence, une explication, une libération.
Et cet article précis est l’un de ceux-là, un article qui ne verra jamais le jour sous sa forme initiale, un article entre-deux, qui raconte la surface et la profondeur, qui fait fi des non-dits et des faux-semblants. Ces destinations ne s’ancreront jamais sur Voyages et Vagabondages comme de simples destinations de voyage. Même s’il n’y a jamais vraiment eu par ici, de simples destinations de voyage, de simples destinations touristiques.
Ces destinations – la Bosnie, le Monténégro, la Croatie – étaient chantantes et m’ont transportée. J’ai toujours souhaité y retourner et revivre ces lieux sous un autre regard, dans une autre énergie, sous d’autres auspices. Mais je n’ai jamais su les écrire.
Alors ces quelques lignes, comme un hommage à tous ces articles que je n’ai jamais écrits, que je n’écrirai jamais…
La Bosnie en solo, Trebinje et les non-dits
Après deux mois de rêve et de vie de nomade digitale en Bosnie, en compagnie de mon amie Nastasya, après les visites et rencontres d’autres nomades digitaux, je me suis retrouvée seule. Pour la seconde fois, quelques six mois après Chiang Mai et la Thaïlande, j’expérimentais à nouveau la « vraie » vie de nomade digitale, celle qui ralentit, celle qui est en communauté, celle qui ressemble un peu plus à une vie sédentaire. C’était une solution à mon burnout, à ma remise en question et une expérimentation pour apprendre à vivre cette vie de rêves, avec plus de douceur et plus de liens.
L’expérience avait été probante, tout du moins en surface. Mais l’Après, mon Après était toujours aussi incertain. Et à nouveau, je me retrouvais seule. Quelques semaines, événements, destinations s’annonçaient et puis, ce serait, à nouveau, le grand vide, l’incertitude.
Une dernière nuit dans notre appartement à Sarajevo et je refermais la porte sur cet heureux chapitre. Dans l’ascenseur, en laissant les clés dans la boîte aux lettres, sur le parking, en jetant un dernier regard à cet immeuble qui portait les traces de la guerre et des bombardements, en marchant vers la station de bus, en trouvant mon bus, en achetant mon ticket et en attendant quelques heures – ces actions que j’avais faites cent fois, mille fois, dans tant de villes et de pays, dans tant de langues et de cultures, ces actions qui me rendaient d’habitude si vivante, boostée à l’adrénaline du changement, de la transition et de mon excellente gestion de ces situations bancales, portant avec fierté ma débrouillardise et sagacité – j’avais le coeur lourd et une profonde envie de pleurer. En cet instant précis, même si je ne me l’avouais pas encore consciemment, même s’il y avait déjà eu des dizaines de préludes à cette certitude, le voyage en solo m’était devenu insupportable. Je ne voulais plus être seule. Mais la voyageuse en solo invétérée, celle qui le prônait haut et fort depuis une décennie, celle qui écrivait justement un livre sur la beauté du voyage en solo, celle dont cette catégorie était un pilier indétrônable sur le blog, n’aurait jamais pu le voir, le reconnaître, l’avouer. C’est seulement en écrivant ces lignes aujourd’hui, trois ans et demi plus tard, que je vois la véracité de ce moment.
Emportée par le momentum de la vie nomade et de cette vie qui m’éloignait de plus en plus de celle que j’étais vraiment, je montais dans un mini-bus brinquebalant et je quittais Sarajevo. Pour un ailleurs qui ne serait pas meilleur. Mais jamais je n’avais appris à rester.
J’aime tant les bus, les trains, les avions, les bateaux, ces moments de transition, ces espaces liminaux, dans l’entre-deux, parce que justement, il n’y a pas de choix à faire. Partir ou rester. Etre ici ou là-bas. Les deux à la fois, toujours. Peut-être aussi qu’ils représentaient les moments où je pouvais être le plus moi-même, laissant tomber le masque de mes émotions, mes réflexions, mes idées, mes intuitions, le temps de quelques heures, n’ayant pas à faire face, dans une pause bienvenue, à cette question de l’appartenance et du sens, qui me rongeait de l’intérieur depuis toujours.
Je suis arrivée à Trebinje, une ville au Sud de la Bosnie, dans la partie serbe du pays, dans une agréable auberge de jeunesse ensoleillée. J’ai fait immédiatement connaissance avec quelques voyageurs et le patron de l’auberge. Tout le monde était très sympathique, et c’était typiquement le genre d’endroits où j’aurais pu faire du volontariat ou rester une ou deux semaines, dans une bulle transitoire, bienheureuse et artificielle. Mais depuis longtemps, un mur s’était créé entre moi et ces voyageurs. A cette question si commune, pour apprendre à se connaître, sur mon parcours, sur mes voyages, sur la durée de mon voyage, même si je ne racontais pas toujours l’histoire complète, il y avait tout de même cette barrière invisible qui se créait. Voilà désormais cinq ans que je voyageais, cinq ans que j’étais nomade. Je n’étais plus touriste, ni tour-du-mondiste, ni voyageuse au longs cours pendant deux ou trois ans. La route était moi, j’étais la route. Et le malaise, ce mur invisible, même s’il n’était jamais verbalisé, était palpable. On ne vit pas sur les routes du monde pendant 5 ans sans raison. Et quelle était cette raison… même moi, je n’en avais pas conscience.
L’histoire de la ville résonnait avec mon propre malaise intérieur. Je n’appartenais pas à cette communauté, je n’y étais pas vraiment à ma place, malgré les apparences, la chaleur de cette auberge et la beauté des lieux. Je ne me sentais pas à l’aise avec le tourisme, dans une ville à l’histoire récente torturée. Les habitants originaux de la ville avaient été forcés à l’exil par la guerre, et les habitants actuels vivaient et travaillaient dans des maisons, des bâtisses, une ville qui ne leur appartenaient pas vraiment, comme si de rien n’était.
Il est plus facile de fermer les yeux, de faire comme si, de noyer la réalité des choses sous des sourires, du soleil, des étiquettes, des panneaux en cyrillique…
J’étais exilée dans mon propre corps, dans ma propre vie et il avait été plus simple d’enfouir cette vérité au fond de moi pendant près de deux ans.
J’ai aimé Trebinje, j’ai aimé la beauté de la ville et du cadre, le mode de vie et l’atmosphère. Mais j’ai emporté avec moi cette énorme malaise, ces non-dits qui dévorent encore un pays, des cultures, les âmes, l’histoire de famille déplacées, divisées, détruites.
Le Montenegro, Kotor, son lac et mes larmes
Deux autres bus, un nouveau pays, un lac, un paysage à couper le souffle.
J’ai loué un appartement Airbnb pour une semaine. Sous couvert d’écriture, de travail, d’un besoin de calme pour ma vie de nomade digitale, je faisais tout mon possible pour me tenir loin de la réalité. Je n’appartenais plus aux auberges de jeunesse et j’avais besoin de solitude pour faire le point. Un appartement Airbnb, comme autre espace transitoire, irréel, confortable.
Autant j’aurais aimé être productive, travailler, écrire, visiter, photographier, aussi peu j’en ai été capable. Dans la solitude de cette appartement, de mon balcon où je voyais la route, le lac et les montagnes au loin, de mon lit qui donnait sur la fenêtre, alors que je voyais le monde, mais que personne ne me voyait, j’ai pleuré tous les jours. Des larmes qui ne se tarissaient pas, des larmes que je n’expliquais pas encore, des larmes qui venaient disparaître dans l’immensité du lac Skadar, des larmes qui n’étaient que le prélude à toutes celles qui allaient s’écouler pendant encore un an. Je crois que si j’avais su l’ampleur du problème, je l’aurais refoulé encore plus longtemps, encore plus fort, j’aurais refoulé ces larmes, pour ne pas vivre la douleur d’un an à genoux.
Je visitais Kotor, Perast et son île, je marchais le long du lac tous les soirs, je m’y baignais tous les jours, pour me donner bonne conscience, pour ne pas trop culpabiliser d’être au paradis et de ne pas en profiter. Je crois aussi que ces temps de pause, ces temps de visite, ma normalité à moi était nécessaire, pour ne pas complètement sombrer, là, quelque part dans un pays inconnu, dans un appartement impersonnel, sans épaule sur laquelle pouvoir m’appuyer, m’ancrer, me relever, si jamais je me noyais.
A chaque promenade au coucher de soleil, à chaque baignade dans l’eau transparente, je me purifiais, je renaissais, je me permettais de découvrir qui j’étais vraiment, ce que je voulais et je laissais les larmes couler, sortir, rugir, faire leur oeuvre.
Loin des touristes, loin de ces cars qui faisaient des allers-retours chaque jour, dans une bulle que je ne voulais pas éclater, je me laissais peu à peu réaliser que vraiment, rien n’allait plu.
Dubrovnik, la Croatie et les faux-semblants
Dubrovnik, une nouvelle auberge de jeunesse, des punaises de lit et le masque qui tombe enfin petit à petit.
Je parlais à une voyageuse de mes états-d’âme. Elle ne pouvait pas vraiment comprendre et comme beaucoup, elle voyait avant tout la magie, le rêve et l’incroyable histoire de ma vie nomade, mais elle m’écoutait tout de même. Et de mettre enfin des mots sur ce malaise avec une inconnue rendait tout cela plus réel, enfin avouable. Car le dire à mes amies nomades, c’était en quelque sorte perpétuer notre souffrance et notre impuissance. « Que faisons-nous ainsi à tourner sur les routes du monde? Comment s’arrêter? Et que faire après? »
Dubrovnik était splendide, au-delà de toutes mes espérances. Comme Venise d’ailleurs. Dubrovnik était aussi insupportable de tourisme, d’excès, de superficialité et de pacotilles. Une fois encore, je me confrontais à une réalité à laquelle je participais et qui me rendait folle. J’avais beau voyager lentement, écologiquement, j’étais moi aussi à Dubrovnik, j’écrirais peut-être un jour sur Dubrovnik et je participais ainsi au tourisme de masse, à la destruction de notre planète, en prônant le voyage comme solution à nos maux, comme distraction à une vie qui ne tourne pas rond, comme pansement à nos vérités intérieures. Ma dissonance et mon conflit intérieur ne pouvaient plus se cacher sur les murs et les plages de la ville.
J’avais envie de hurler. J’avais envie de disparaître. Mais il était déjà temps de remettre le masque.
Dubrovnik, forteresse assaillie, victime de Game of Thrones, des bateaux de croisière, de sa popularité, de notre humanité devenue folle. Et dans ma forteresse intérieure, les murs s’écroulaient et se haussaient en même temps. Nous aimons à danser sur les ruines de notre monde. C’est toujours plus simple que d’accepter la destruction. La naïveté, l’innocence, l’insouciance de l’illusion et d’une vie aveugle.
Mon Papa venait me rendre visite pour 10 jours, ses vacances annuelles et je n’avais pas la force et le courage de sombrer devant lui. J’ai enfilé mon rôle de guide et de voyageuse, j’ai rajusté le masque et je suis encore ébahie de voir à quel point il était facile pour moi de le faire, à durée déterminée. Non pas que l’armure était infaillible, mais ma nature de caméléon savait encore prendre le dessus et jouer un rôle à merveille.
J’ai aimé ce voyage, ces vacances, la Croatie hors saison, la douceur de vivre, mes baignades quotidiennes, nos errances joyeuses, les couchers de soleil sur mon âme. Je ne le savais pas encore, ou peut-être que si inconsciemment, mais c’était le dernier interlude, le dernier simulacre, un dernier vrai hourra, les derniers moments où je pouvais me dire nomade, comme si de rien n’était, comme si tout allait bien, comme si les paillettes, la fête et la jetset était le véritable reflet d’un pays, de ma vie de rêve.
Belfast, le bout de la route
Mon papa est reparti. J’ai passé une nouvelle nuit, seule dans un appartement Airbnb impersonnel, transitoire. Je m’envolais pour Belfast et une conférence de blogueurs de voyage.
A l’arrivée, aux petites lueurs de l’aube, seule voyageuse de bric et de broc parmi les vacanciers irlandais, je me faisais interrogée, pour la première fois en Europe et au Royaume-Uni, sous des airs de Brexit, sur mes intentions et mes voyages passés. Cela ne durait que quelques minutes, mais encore une fois, je me retrouvais étrangère, exilée, sans appartenance. Et le Royaume-Uni, le seul pays où j’avais eu ou cru en un vrai ancrage, me faisait sentir comme une étrangère. Je n’avais plus nulle part où me tourner.
L’Irlande du Nord, ses deux communautés, cette nation entre-deux, ce conflit latent, sous-jacent, encore une fois en miroir de mon intériorité.
A Belfast, j’ai essayé de faire bonne figure. Mais de simples questions, quelques phrases lors de certaines conférences pouvaient me pousser très rapidement à pleurer. Je suis restée professionnelle, j’ai fait mon travail, j’ai écrit mes articles, jusqu’à ce délicieux voyage de blogueurs à Manchester. Mais ce n’était plus la vie que je voulais mener. Comment m’en sortir, je n’en avais aucune idée.
J’étais arrivée au bout de la route. Il n’y avait pas de retour possible. Il était temps de confronter ce que j’avais fui sur les routes du monde pendant ces cinq années. J’atterrissais à Paris, accueillie par une amie, et je commençais une thérapie. Cette nouvelle route serait longue. Mais il n’y avait plus de retour en arrière possible. Les digues étaient tombées et mes larmes jonchaient mes voyages, mes mots, mon quotidien. C’était à leur tour d’écrire l’histoire. La vraie histoire cette fois-ci.
Et ces villes, ces pays, ces cultures aux histoires torturées, cachées, aux murs et frontières invisibles, m’ont permis de comprendre des bouts de moi, ces murs et trous invisibles qui perçaient mon âme. Et toujours, je serai reconnaissante à ces routes, ces chemins détournes, ces espaces transitoires, ces bulles que j’ai traversés, dans lesquels j’ai vécu et qui pendant toutes ces années, m’ont apportée une certaine appartenance et sécurité. Ils ont été mes canots de sauvetage et m’ont permis de garder la tête hors de l’eau, me comprenant mieux que moi-même je ne l’aurais jamais pu. Alors merci à eux, merci à elles, même si jamais je ne pourrais leur rendre hommage dans des articles de blog.
Armée pour faire face à mes démons
Inconsciemment donc, je n’ai jamais raconté et écrit ces destinations, car cela aurait été superficiel, faux, dissonant. Car je n’étais pas prête non plus à tout raconter avec honnêteté, authenticité et intégrité, ni avec la sagesse du recul et de l’introspection. C’est maintenant chose faite. En tout cas partiellement. Cette histoire ne faisait alors que commencer et trois ans et demi plus tard, je suis prête à l’écrire et à la raconter.
Alors que j’ai été incapable d’écrire mon livre sur le voyage en solo, tout simplement car il n’était pas le vrai reflet de mon message, de ma vérité et de mon intériorité, aujourd’hui, je suis prête à raconter la vraie histoire, à tes côtés.
Je raconte ce récit dans l’Envol, un livre audio intuitif, qui racontera mon processus de guérison, mes éveils écologique, créatif et spirituel et tout le cheminement qui m’a menée à prendre ma retraite du blog, me sédentariser à Edimbourg, reprendre les études, devenir scénariste et coach créativité et Dharma, après le burnout, après toute cette remise en question, après ces durs moments. Si la route n’a pas toujours été facile, mes mots se veulent porteurs de lumière, d’espoir, pour montrer la magie qui se trouve de l’autre côté.
L’Envol est une oeuvre créative, mais également une performance artistique, puisque j’écrirai spontanément, intuitivement les chapitres semaine, par semaine, à tes côtés, à ton écoute, au fil des mois, avec le recul et l’introspection du moment présent, expérimentant avec la structure et le processus de création intuitif.
Découvre L’Envol, mon premier livre
L’Envol est mon premier livre, ouvrage autobiographique et poétique, qui dépeint et retrace ma guérison, mon Envol et mes éveils écologiques, créatifs et spirituels, au fil de la route, de visions et des mots, après le burnout, après le nomadisme, après l’errance, après Voyages et Vagabondages.
L’Envol, mon premier livre, mémoire intuitif, poétique et spirituel, est disponible dès le 19.03.2023 au format de livre audio et e-book.
Pour en savoir plus et lire et écouter L’Envol, c’est par ici.
Pour te procurer le livre audio et le livre numérique
Pour te procurer simplement le livre numérique
Pour aller plus loin
Pour lire ou écouter un Chapitre Bonus à L’Envol et partir à la chasse d’un bon de réduction unique, c’est par ici: Faire le pont. Jusqu’à l’union.
Je vis l’Attente par là, l’article pour écouter le Chapitre 5 de l’Envol, L’Attente.
Je raconte ici mon processus créatif et intuitif d’écriture, au tout début de l’écriture de l’Envol.
Après toutes ces années que tu as passé à mes côtés, je serai heureuse et reconnaissante de te t’avoir à mes côtés pour l’Envol. Merci de ta fidélité, merci de ta lecture et de ton écoute et à bientôt, ici ou ailleurs, sur les routes du monde et de la créativité.